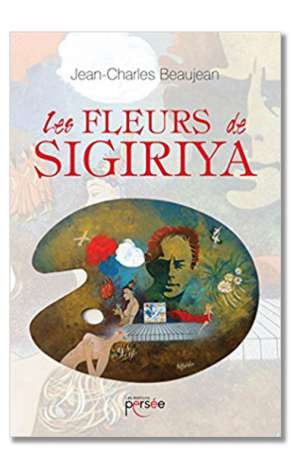Pianiste, improvisateur dans l’âme, Jean-Charles Beaujean ne peut s’empêcher de glisser une touche d’improvisation dans ses romans qu’il a commencé à écrire il y a quelques années. Dans cet entretien, l’auteur belge nous dévoile entre autres choses quelques clés de ses deux derniers récits publiés aux Editions Persée, Les Fleurs de Sigiriya et On peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du ciel. Une découverte !
Mon travail est sans tabou
Baron est un veinard. Plein aux as grâce à un héritage, il est aussi un pianiste surdoué en improvisation. Homme à femmes au charme irrésistible, il vit dans un quartier populaire de Liège cachant bien sa fortune et son passé de légionnaire. On est en 2040 dans une société pas très différente de la nôtre. Juste un cran pire. Mais pour Baron comme pour n’importe qui, la chance peut tourner, comme les amours.
Nouveau venu sur la scène littéraire belge, Jean-Charles Beaujean signe avec Les Fleurs de Sigiriya, une fable apocalyptique, premier de ses deux romans publiés en 2016. On peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du ciel adopte un ton beaucoup plus léger, burlesque même. On y suit un notaire célibataire, Spencer Gugusse, bien décidé à changer sa vie monotone en se débarrassant de ses fantasques alter ego et de son encombrant locataire. La délivrance viendra, il en est convaincu, par l’amour. Mais il ne possède pas de mode d’emploi. A moins qu’il ne le trouve dans l’écriture.
Vous avez publié sur le tard, ces récits ont-ils mis longtemps à murir ou sont-ils nés quand vous vous êtes mis à écrire ?
Quand je commence l’écriture d’un ouvrage, je fais confiance à l’improvisation et ensuite je me permets d’en retravailler certains éléments par la suite. J’ai toujours écrit, une pièce de théâtre à 14 ans et de la poésie. Quand j’ai décidé de me consacrer pleinement à l’écriture, fin 2010, je n’avais rien publié mais j’avais derrière moi des bribes de textes. Depuis 2012, j’ai écrit un livre par an, mais j’ai besoin d’une période de deux ou trois ans de décantation à partir de mes notes. C’est ma manière de travailler. Le travail de correction est énorme. Je mise beaucoup sur la structure et quand elle est en place et que je possède suffisamment d’éléments, je peux tout jeter et me lancer dans l’écriture.
Les Fleurs de Sigiriya mixe plusieurs récits, le thriller avec le personnage du sniper, l’anticipation distillée par petites touches, le récit d’aventure lié au passé légionnaire de Baron et enfin le récit d’amour. Aviez-vous l’envie d’embrasser la complexité de la vie ?
Tout ça n’est pas prémédité. Quand je travaille, j’assemble les pièces d’un puzzle. Avec la touche d’anticipation, j’avais envie de me créer des leviers pour parler de l’époque d’aujourd’hui. Le sniper, c’est le thème de l’épée de Damoclès qui nous pend au nez dans la société qui est la nôtre. Je ne veux pas pour autant être dans la prise de position polémique. Je mets simplement le doigt sur les choses telles que je les ressens. Si je devais définir un élément de style, je dirais que je travaille caméra à l’épaule afin de donner au lecteur le meilleur environnement visuel à mes histoires.
Le personnage du sniper est-il inspiré par le tueur de la place Saint-Lambert en 2011 ?
Cette affaire du sniper de Liège m’a interpellé sur le plan humain, mais au moment d’entamer le roman, je n’y pensais pas du tout. De toute façon, si mes histoires reflètent notre société, j’aime brouiller les pistes. C’est pour cela que j’aime introduire des doubles fins. A la fin du livre, Baron avance qu’il pourrait être le sniper en même temps qu’il le réfute. C’est au lecteur à se faire une opinion.
On est en 2040, mais on ne sait pas grand chose sur cette époque, si ce n’est qu’on paie avec des dollars européens et qu’un jour les autorités qui gouvernent ont décidé d’interdire la religion.
Les dollars européens, c’est une allusion à l’union américano-européenne qu’on impose à la population alors que ce n’est pas ce que veulent les gens. Je ne me vois pas comme un pamphlétaire, mais nous vivons dans une société où la laïcité est mise à toutes les sauces et va dans la négation d’un certain passé. Quand je vais dans une église, je me recueille et ça me regarde, mais quand j’écris mon travail est sans tabous. Il faut montrer ce qui est beau mais aussi ce qui est laid et comme le dit Baudelaire, C’est dans la boue qu’on va chercher l’or. Mais rien n’est figé. Des idées et des pratiques qu’on croyait disparues peuvent revenir. Ça s’est vu au XIXe avec la musique baroque et celle de de Bach en particulier, quasiment oubliées à l’époque et redécouverte par le grand public grâce à Felix Mendelssohn.
Dans vos romans, la ville de Liège est très présente, est-ce important pour vous ?
S’il y a une chose dont j’ai vraiment horreur, c’est d’être assimilé à un écrivain liégeois. Je suis un écrivain point. Je n’ai rien contre Liège évidemment. Le hasard a fait que Baron habite dans le quartier Saint-Léonard et que Spencer Gugusse occupe un immeuble du boulevard d’Avroy. Bien souvent, on catalogue les gens en fonction de leur origine. Je suis pianiste aussi, mais je ne suis pas pianiste liégeois. Pas plus que je ne fais de la poésie liégeoise. Quel que soit son lieu de résidence, l’écrivain est avant tout un artiste.
Vous avez aussi un lien très fort avec la poésie ?
C’est ma première forme d’expression écrite avec le théâtre. J’ai commencé à écrire des poèmes vers 12-13 ans. Cette poésie m’a suivi tout au long de ma vie. L’écriture poétique m’intéresse parce qu’elle va au-delà de la poésie. La poésie ne se limite pas aux vers, aux sonnets ou aux haïkus, elle peut se retrouver dans un roman. A la Recherche du temps perdu est un poème de 2600 pages.
On peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du ciel est présenté comme un roman théâtral, qu’entendez-vous par là ?
Dès le début, je savais que le récit pouvait être joué au théâtre. Ce n’est pas une pièce, j’ai maintenu ma technique d’écriture tout en sachant qu’elle pouvait être adaptée au théâtre. Il y a de l’humour, beaucoup de dialogues, mais en l’état, il n’est pas transposable à la scène. En France, j’ai déjà eu plusieurs marques d’intérêt pour adapter le roman au théâtre. Je ne suis pas dramaturge ni scénariste. Il est possible que j’intervienne dans les adaptations.
C’est un récit plus léger qui joue avec le burlesque et avec la farce ne fut-ce qu’avec les noms des personnages qui s’appellent Spencer Gugusse, Jean-Cactus Poupette ou Lucidolle Compagnie ?
L’écriture est pleine de fantaisie mais ce n’est pas qu’un récit ubuesque. Le point de départ et le motif central du roman, c’est le célibat, sagesse ou mort lente. Au final, on reste seul, toujours seul. J’ai pensé que beaucoup de gens pouvaient s’y retrouver. Derrière cette fantaisie, il y a pas mal de sentiments, que Spencer n’arrive pas à sortir de lui.
Pour cela, il a recours, sous les conseils de son coach en écriture à l’écriture automatique. La pratiquez-vous aussi ?
L’improvisation peut être catharsique. Dans le cas de Spencer, l’écriture automatique est une manière d’extérioriser ses émotions, de contourner un enfermement. Je crois qu’on vit tous une forme d’enfermement. Même les extravertis. Personnellement, j’aime beaucoup l’improvisation, que je pratique depuis longtemps. J’aime cette écriture qui n’est pas contrôlée, mais il faut un certain respect vis-à-vis du lecteur. Il faut retomber sur une narration qui lui permette de ne pas perdre le fil. Quelqu’un comme Frédéric Beigbeder a dit qu’il ne supporte pas l’intrigue mais ce n’est pas du tout mon registre. Je n’aborde pas un livre comme une partie d’échec avec une ouverture de partie, un développement et une conclusion. J’ai besoin d’une structure pour ensuite m’en libérer.
Les Fleurs de Sigiriya, Jean-Charles Beaujean, Éditions Persée, 400 pages, 23,90€ Disponible sur notre BAZAR e-SHOP
On peut toujours mourir écrasé par une vache tombée du ciel, Jean-Charles Beaujean, Éditions Persée, 226 pages, 18,80€ Disponible sur notre BAZAR e-SHOP